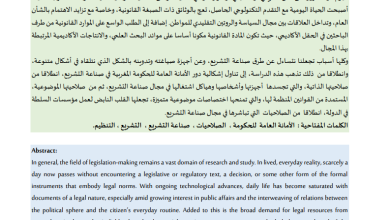L’exonération de la responsabilité de la banque notificatrice : dilemmes et enjeux juridique – Mohammed Amine Jbilou
Exemption from Liability of the Notifying Bank: Legal Dilemmas and Challenges

L’exonération de la responsabilité de la banque notificatrice : dilemmes et enjeux juridique
Exemption from Liability of the Notifying Bank: Legal Dilemmas and Challenges
Mohammed Amine Jbilou
Etudiant en cycle doctoral à l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Doctoral student at Sidi Mohamed Ben Abdellah University
لتحميل الإصدار كاملا
Résumé :
Cet article examine les dilemmes et enjeux juridiques liés à l’exonération de la responsabilité de la banque notificatrice dans le contexte des opérations de crédit documentai re. Nous analysons les implications de cette exonération pour l’importateur, qui se voit privé de tout recours contre la banque notificatrice en cas de manquement à ses obligations. Cependant, des voies de recours alternatives sont envisageables, telles que des actions délictuelles ou extra-contractuelles. Nous présentons des exemples de décisions de tribunaux marocains et français qui illustrent l’application de cette responsabilité et son impact sur les parties concernées. Enfin, nous soulignons l’importance d’un équilibre entre les intérêts des banques et la sécurité de l’importateur dans le cadre du crédit documentaire.
Abstract:
This article examines the legal dilemmas and issues surrounding the exoneration of liability of the notifying bank in the context of documentary credit operations. We analyze the implications of this exoneration for the importer, who is deprived of any recourse against the notifying bank in case of failure to fulfill its obligations. However, alternative remedies are available, such as tort or extra-contractual actions. We present examples of decisions from Moroccan and French courts that illustrate the application of this liability and its impact on the parties involved. Finally, we emphasize the importance of striking a balance between the interests of banks and the security of the importer in the documentary credit framework.
Introduction :
Le banquier qui ne prend pas soin de transmettre l’accréditif conformément aux instructions de l’importateur, sans retard et en utilisant le mode de transmission prévu ou qu’il juge lui-même à bon droit opportun, devra assumer la responsabilité des conséquences indésirables occasionnées. La sécurité de l’importateur qui lui a confié cette mission et lui accordé sa confiance, impose la reconnaissance d’une telle responsabilité. Toutefois, les RUU dans une tendance exagérément protectrice des banques, ont prévu plusieurs cas exonératoires de responsabilité profitant aux institutions bancaires. Les exonérations diminuent, dans une large mesure, et de façon assez critique la sécurité dont devrait bénéficier l’importateur pendant la transmission de l’accréditif.
L’exonération de la responsabilité de la banque notificatrice est un principe juridique important dans le droit bancaire, en particulier dans le contexte des crédits documentaires. Pour comprendre cette question en détail, il est essentiel d’examiner le cadre juridique qui entoure cette exonération et les principaux arguments qui y sont associés.
La responsabilité de la banque notificatrice est régie par les dispositions légales comme la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir N° 1-96-83 et les conventions internationales pertinentes, telles que la Convention de Genève sur les lettres de crédit de 1930, la Convention de Vienne sur les lettres de crédit de 1986 et les règles et usances uniformes régissant les crédits documentaires (RUU 600 ou RUU 700).
La banque notificatrice est généralement considérée comme un simple messager, chargée de notifier au bénéficiaire l’existence d’un crédit documentaire émis par la banque émettrice. Elle n’est pas directement impliquée dans l’exécution ou l’interprétation des termes et conditions du crédit documentaire.
Dans l’intention de protéger les banquiers, les RUU ont prévus plusieurs dispositions limitant leur responsabilité. De telles dispositions affaiblissent en même temps la sécurité de l’importateur (Sec. 1).
Ainsi, l’engagement de la responsabilité bancaire, et corrélativement, le recours que le donneur d’ordre peut éventuellement exercer contre la banque en réparation du dommage que cette dernière lui a causé est une matière assez délicate[1]. Toutefois, la jurisprudence marocaine se montre assez fiable en la matière (Sec. 2).
Section 1 : La reconnaissance de l’exonération de responsabilité de la banque notificatrice : Perspectives et implications
La reconnaissance de l’exonération de responsabilité de la banque notificatrice nécessite une analyse approfondie des perspectives juridiques et des implications pratiques. Dans cet article, nous examinerons de manière détaillée cette question complexe.
Il est bien établi qu’à défaut de transmission soigneuse, les banques seront tenues pour responsable et devront assumer les conséquences qui découlent de leur fait personnel. Cette règle de la responsabilité personnelle des banques n’est pas absolue. Elle a été fortement relativisée par les RUU. Les banques jouissent d’une large exonération de responsabilité personnelle dans la transmission de l’accréditif. « Il est irréprochable d’exempter la banque de la responsabilité pour les questions en dehors de son contrôle. Mais, parfois elles essayent d’aller plus loin et s’excuser des erreurs relevant de leur propre chef ». L’ampleur de ces exonérations prévues par les RUU, fait croire que les banquiers sont exagérément protégés et que ces règles les poussent à la négligence et au manque de rigueur au détriment de l’importateur qui subira de leur fait un préjudice non réparable. Il serait, cependant, erroné de croire ainsi, parce que ces exonérations sont assorties de limites empêchent que la sécurité de l’importateur soit moise en échec.
Dans cette section pertinente, nous aborderons en premier lieu l’ampleur de l’exonération bancaire (A) et en second lieu les limites de cette exonération (B).
A- L’étendue de l’exonération accordée aux banques
L’étendue de l’exonération accordée aux banques fait référence à la portée et à l’ampleur de la protection légale dont bénéficient les banques en matière de responsabilité. Dans de nombreux systèmes juridiques, les banques peuvent être exonérées de certaines responsabilités dans certaines circonstances spécifiques. Voici quelques informations juridiques importantes à considérer concernant l’étendue de cette exonération.
Les banques bénéficient d’un champ d’exonération assez large. L’exonération de responsabilité s’applique non seulement en cas d’erreur dans la transmission, mais aussi en cas d’erreur de traduction ou d’interprétation et encore en cas d’interruption involontaire d’activité[2].
I. En cas d’erreur dans la transmission
En cas d’erreur dans la transmission, l’exonération de responsabilité de la banque notificatrice peut être soumise à certaines conditions et limites.
Les banques sont exonérées de toute responsabilité en cas d’erreurs dans la transmission. L’article 16 des RUU 500 et l’article 35 (1) et (2) des RUU 600, prévoyant cette exonération, ont eu le soin de traiter deux questions, à savoir le type d’erreur pardonnable et la technique de transmission utilisable.
a- Types d’erreur pardonnable :
L’article 16 des RUU 500 et l’article 35 (1) des RUU 600 citent des cas d’erreurs tels que : la perte en transit, le retard et la mutilation pendant la transmission de tout message, lettre ou document. A ces exemples, ces deux articles ajoutent un critère abstrait et général selon lequel les banques seront exonérées de responsabilité dans la transmission « en cas d’autres erreurs ». Ce critère est très vague et susceptible de justifier l’exonération des banques pour toute erreur non citée. Il offre aux banques une exonération illimitée qui leur procure une protection très étendue.
Cette disposition est d’application large. D’une part, ce texte s’exprime en des termes généraux et assez vagues. En effet, on ne sait pas exactement si la perte ou le retard doit avoir lieu nécessairement à la poste ou chez le banquier. Ainsi, a-t-il été écrit que « l’expression est vague et n’est pas du tout claire ». D’autre part, l’exonération en cas de perte s’applique à tous les rapports de droit en cause. C’est ce qu’a décidé, d’ailleurs, la Cour d’Appel de Paris qui a écarté l’argumentation de l’importateur considérant que l’exonération de responsabilité ne s’appliquait pas au rapport de droit le liant à la banque émettrice et qui a infirmé la décision du premier juge en déclarant que : « cette stipulation générale constitue une exonération non limitée ».
La révision de 2007, tout en reprenant l’article 16 des RUU 500, ajoute au sein de son article 35 un alinéa 2 dans lequel elle prévoit un cas concret de perte en transit des documents. Cet alinéa exonère la banque désigné de toute responsabilité en cas de perte en transit des documents envoyés à la banque confirmatrice ou émettrice et lui assure un droit au règlement de l’une ou de l’autre des deux banques, pourvu que la présentation soit conforme. Cet article met en lumière l’intention d’élargir les exonérations des banques afin de mieux les protéger au détriment de l’importateur. Cette règle parait discutable à plusieurs égards. D’un côté, elle suppose que la banque désignée peut justifier la conformité des documents perdus en présentant à la banque confirmatrice ou émettrice de simples copies. Elle suppose, par ailleurs, que la banque désignée a bien rempli son obligation d’examen sans erreur parce que l’examen de conformité est un examen tout à fait objectif qui doit aboutir au même résultat qu’il soit exercé par la banque désignée, confirmatrice ou émettrice. L’unicité ou l’uniformité du résultat de l’examen découle du fait que depuis la révision de 2007 la norme de l’examen raisonnable et subjectif a été supprimée et qu’une norme d’examen objectif l’a remplacé. Il s’agit de la norme des pratiques bancaires internationales qui figure à l’article 2 (5) des RUU 600. Cette déduction ne parait pas toujours correcte. D’un autre côté, elle met en cause la sécurité de l’importateur dans la mesure où ce dernier sera dans l’impossibilité de retirer la marchandise à défaut de détention des documents notamment du connaissement maritime, le cas échéant.
b- Technique de transmission utilisable :
À l’origine, les crédits documentaires étaient notifiés par écrit, la banque émettrice expédiant par voie postale la notification. Avec l’apparition des techniques de télétransmission comme le télex, les crédits ont de plus en plus été notifiés par ces nouveaux procédés au fur et à mesure de la diminution de leurs coûts[3].
L’article 16 des RUU 500 prévoit que l’exonération ne s’applique qu’aux erreurs de transmission par télétransmission. Cet article prévoit donc une exonération limitée des banques. Il s’en suit que les banques ne seront pas exonérées en cas d’erreurs occasionnées lors de transmission pas des techniques autres que la télétransmission comme le fax, le télex, etc. Cet article peu favorable aux intérêts des banques et ne leur procurant pas assez de sécurité, est malvenu. La CTPB, toujours soucieuse de sécuriser les institutions bancaires qui sont au cœur de cet instrument documentaire, a profité de la révision de 2007 pour modifier l’article 16 des RUU 500 sur cette question et introduire au sein de l’article 35 (1) des RUU 600 une règle plus protectrice des banques qui comble l’insuffisance de l’article 16 ancien. Cette règle supprime l’exigence de transmission par télécommunication et la remplace par la transmission par toute technique prévue à cet effet au crédit ou en cas de silence du crédit, par toute technique jugée opportun par le banquier. Cet ajout manifeste l’intention de la CTPB de mieux protéger les banques. Il met en exergue l’élargissement de la sécurité des banques au détriment de l’importateur par la révision de 2007.
II. En cas d’erreurs de traduction ou d’interprétation
L’article 16 des RUU 500 et l’article 35 (3) des RUU 600 exonère le banquier de toute responsabilité quant aux erreurs de traduction ou d’interprétation de termes techniques. Ils l’autorisent même à émettre la lettre de crédit lorsqu’il reçoit des instructions en langue étrangère sans les traduire. Ceci afin de « ne pas avoir à supporter la responsabilité des erreurs ou imprécisions de traduction ». M. ELLINGER propose, à ce propos, l’ajout d’une disposition aux RUU considérant l’anglais comme la seule langue à employer dans toutes les transactions de crédit documentaire, pour « encourager l’uniformité et éliminer les erreurs résultant de l’utilisation de lettres de crédit exprimées en d’autres langues ». Le CCU a aussi prévu une règle semblable au sein de son article 5-107 (4). Il prévoit que le client assume : « tous les risques de transmission et de traduction raisonnable ou interprétation de tout message lié à un crédit ». Il apparaît clair ainsi que la formulation de l’article 16 des RUU 500, est plus large puisque toute traduction est exonératoire de responsabilité sans besoin qu’elle soit raisonnable, similairement au droit américain. Elle fournit aux banques une exonération étendue qui implique plus de sécurité en leur faveur. Cette exigence introduite par le droit américain est sans doute appréciable parce qu’elle entoure le pouvoir discrétionnaire du banquier par des limites visant à empêcher toute conduite négligente ou abusive de sa part. L’importateur lésé peut y trouver refuge pour invoquer la responsabilité du banquier. L’exigence de l’article 5-107 (4) demeure, toutefois, peu satisfaisant puisqu’elle s’applique uniquement pour la transmission et la traduction de tout message lié au crédit et n’a pas été étendue à son interprétation.
III. En cas d’interprétation involontaire de l’activité bancaire
Les RUU exonèrent les banques de toute responsabilité pour les conséquences de l’interruption de leur activité en cas de force majeure. Le contenu de ce concept a été définit par l’article 17 des RUU 500 comme couvrant les « faits de Dieu », les émeutes, les troubles civils, les insurrections, les guerres, le grèves ou « lockouts ». Il ajoute, en sus de ces exemples concrets, un critère abstrait selon lequel, de façon générale « toute autre cause indépendant de la volonté des banques » est exonératoire de responsabilité bancaire. L’article 36 (1) des RUU 600 a repris l’article 17 des RUU 500 auquel il a ajouté la référence à un cas spécifique de force majeure qui semble à la mode aujourd’hui. Il s’agit des actes de terrorisme. L’ajout de ce nouveau concept de terrorisme est inutile parce qu’il est forcément intégré dans le critère abstrait adopté puisque le terrorisme est bien une cause d’interruption d’activité indépendante de la volonté de la banque. Il constitue un concept assez flou et difficile à définir parce qu’il n’identifie pas une situation précise à laquelle il fait allusion. Il permet au banquier de s’en prévaloir dans un très grand nombre de situations qu’il peut librement imaginé. Ceci constitue une extension exagérée de l’exonération du banquier. Il manifeste l’intention des rédacteurs de ces règles de protéger au mieux les banques au détriment de l’importateur.
A la survenance d’un cas de force majeure telle que décrite ci haut, l’article 17 des RUU 500 ainsi que l’article 36 (2) des RUU 600 décharge le banquier de toute obligation de régler un crédit qui a expiré durant l’interruption de son activité due à un cas de force majeure. L’article 17 des RUU 500 autorise le crédit stipuler le contraire. Toutefois, la révision de 2007 a supprimé cette possibilité au sein de l’article 36 (2) des RUU 600, toujours dans le dessein de réduire les limites à l’exonération bancaire de responsabilité en vue de mieux protéger les banques[4].
Un arrêt de la Cour de Cassation a ainsi admis qu’une situation exceptionnelle de grève soit considérée comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité (Cass. Com., 6 mars 1985 : Bull. civ. 1985, IV, n° 90, p.80 ; D, 1986, inf. rap. p. 213obs. Vasseur). L’on observera que la notion de la force majeure revêt une signification spécifique s’agissant des crédits documentaires, puisque l’article 36 des RUU 600 étend l’exonération de la responsabilité des banques à « tout cas de force majeure, émeutes, troubles civils, insurrection, guerres, acte de terrorisme, ou par toutes grèves ou lock-out ou toutes autre cause indépendante de leur volonté »[5].
B- Évaluation des limites applicables à l’exonération bancaire
Les termes des dispositions des RUU édictant ces exonérations, s’exprimant de manière générale sans prévaloir de limitations, laissent croire que les banques bénéficient ainsi d’une protection exagérée au détriment de la sécurité de l’importateur. Le bénéfice de ces exonérations n’est pas cependant absolu. Il est tributaire du respect par le banquier de certaines limites sans lesquelles la sécurité de l’importateur sera battue en brèche. Le banquier doit agir sans faute de sa part. L’exonération prévue « n’est pas destinée à servir de rempart qu’au ´banquier qui a travaillé en conscience`, c’est-à-dire en prenant toutes les précautions possible ».
Il est judicieux d’interpréter ces exonérations comme se référant uniquement à des circonstances dans lesquelles le banquier n’a aucun contrôle. En effet, « ces mots ne devraient pas être interprétés en tant qu’exemption d’une banque de sa responsabilité lorsqu’elle fait fautive ». En conséquence, il pourrait apparaître normal d’exonérer les banques des erreurs relevant de l’ordinateur par exemple. Il ne saurait en être de même pour celles imputables aux activités dont la banque détient la maîtrise. Il en est exclu le faite que la banque puisse échapper à la responsabilité de ses propres fautes professionnelles. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’elle fait entrer un message sur un format inapproprié.
La CCI en incorporant ces exonérations au sein des RUU n’avait pas l’intention de protéger les banques contre leur propre négligence. Aucun texte des RUU, il est vrai, ne le prévoit expressément. Toutefois, cette règle peut se justifier par l’adage « memo auditeur » qui signifie « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Elle peut également trouver fondement dans les principes du droit commun qui n’exonèrent pas le banquier « des conséquences de son dol, auquel traditionnellement la jurisprudence assimile la faute lourde » ou dans le principe d’exécution de bonne foi des transactions[6].
Section 2 : Le recours pour l’importateur d’intenter une action en justice et la compétence des tribunaux marocains
L’exonération de la responsabilité de la banque notificatrice implique la privation de l’importateur de tout recours contre le banquier. Par ailleurs, si la banque intermédiaire viole ses obligations issues du crédit elle sera, il est vrai, protégée contre l’action directe de l’importateur. Mais, ce dernier disposera quand même d’autres voies de recours pour engager sa responsabilité. L’application d’une telle responsabilité par les tribunaux marocains demeure faible.
Notre section revête une importance capitale pour notre article. C’est pourquoi nous allons les aborder en deux parties distinctes. La première partie portera sur le recours de l’importateur contre le banquier intermédiaire (A), tandis que la seconde partie se penchera sur l’application de cette responsabilité par les tribunaux marocains : son efficacité (B).
A- Le recours de l’importateur à l’encontre du banquier intermédiaire
La banque intermédiaire est tenue de se conformer aux instructions de l’importateur et ne doit pas faire un usage abusif de sa liberté. L’importateur démuni de tout lien direct avec elle et par conséquent démuni de toute action contractuelle, bénéficie d’autres moyens pour faire prévaloir ses droits. Il peut, en particulier, la poursuivre sur le plan extra contractuel ou délictuel.
Le tribunal de Commerce de Nancy a eu l’occasion de l’affirmer dans un arrêt du 08/01/1988. Une banque notificatrice a, par négligence, manqué d’aviser le bénéficiaire de l’ouverture d’un crédit documentaire à son profil. Le bénéficiaire a demandé la résolution du contrat de base. L’importateur a subi un préjudice. Il a agi en responsabilité contre tous les intervenants bancaires. Le Tribunal a très justement écarté la responsabilité de la banque émettrice en raison de l’absence de faute dans son comportement et en application de l’exonération de l’article 12 des RUU de 1974. Elle a, en revanche, retenu la responsabilité extra contractuelle de la banque notificatrice. En prenant cette position, il a pu être écrit : « cette jurisprudence a le mérite de renforcer l’efficacité du crédit sans essuyer l’inconvénient de contredire ses principes fondamentaux ».
L’exonération de l’article 18 des RUU 500 et celle de l’article 37 des RUU 600 ne font pas échec à la sécurité de l’importateur ni des banques intervenantes. Elles s’inscrivent dans des limites raisonnables. C’est l’obligation de diligence du banquier qui assure l’équilibré des intérêts en cause. Ainsi, on a pu démontrer que la sécurité de l’importateur ne sera pas vraiment mise en cause par l’incorporation d’article au sein des RUU instaurant certains cas d’exonération de responsabilité au profil des banques pourvu que certaines limites soient strictement respectées et pourvu que la jurisprudence s’impose en tant que gardien éveillé des droits de l’importateur sur ce plan. Il serait peut être prudent de la part de l’importateur, afin d’éviter absolument les risques d’une mauvaise application de ces dispositions immunitaires d’exiger dans la convention de base de manière expresse d’écarter purement et simplement l’application des articles 16 à 18 des RUU 500 ou 35 à 37 des RUU 600[7].
Il en résulte, que le donneur d’ordre ne peut agir contre la banque notificatrice ou la banque désignée sur la base de droit commun du mandat. Ni l’une ni l’autre n’a la qualité de sous mandataire[8].
Cela veut-il dire que le donneur d’ordre est dépourvu de tout recours ? La réponse semble par la négative. Lorsque la banque intermédiaire notifie le crédit ou est désignée pour le réaliser, on se trouve en présence d’une chaîne de contrats liés par une unité de but. En présence de telle situation, la doctrine reconnaît l’existence d’action contractuelles directes entre le destinataire du service (le donneur d’ordre) et le tiers que son cocontractant s’est substitué (la banque intermédiaire). Pour cela, Vasseur considère que le donneur d’ordre ne peut agir contre la banque notificatrice que sur le terrain délictuel[9].
Sous un autre angle, le recours du donneur d’ordre contre la banque confirmatrice ne peut se situer que sur le terrain délictuel[10].
B- L’efficacité de l’application de cette responsabilité par les tribunaux marocain
Il est alors tout à fait compréhensible qu’à défaut de notification, les parties ne peuvent subir les conséquences des manquements du banquier, celui-ci engagera certainement sa responsabilité à l’égard des parties, notamment l’acheteur, aucun motif ne pourra alors être avancé pour étudier au peines pouvant être prononcées à son encontre, la position est d’ailleurs confirmée par plusieurs décisions rendues par les tribunaux marocains dont notamment l’arrêt N° 2182 rendu le 13 juillet 2000 par la Cour d’Appel de Casablanca, plus surprenant encore sera le jugement N° 0049/2001, rendu le 4 janvier 2001 par le Tribunal de Commerce de Casablanca, les juges en l’espèce ont vu en la détention préventive de l’acheteur une raison insuffisante pour désengager le banquier de son obligation de notification[11].
De sa part, la jurisprudence marocaine a confirmée, que la responsabilité de la banque se pose devant ses clients, chaque fois lorsqu’elle ne procède pas à leur notifier de l’acceptation de l’ouverture de l’accréditif. A cet égard, un jugement du tribunal de première instance d’Anfa Casablanca – inédit, datant du 30 novembre 1995 dossier commercial N° 4295/94 « au moment où l’établissement bancaire a reçu la notification de l’acceptation de l’ouverture du crédit, engage sa responsabilité devant ses clients, s’elle n’a pas pris tous les soins nécessaires de lui informer de cette ouverture, et pour cause le client aura un droit aux dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du gain manqué »[12].
Corollairement, il est à noter que la responsabilité de la banque notificatrice est également engagée au cas où elle n’informe pas, dans les délais raisonnables, le bénéficiaire. C’est dans ce sens que le tribunal de 1ère d’Aїn Sebaâ a rendu son jugement du 15 janvier 1997 motivé comme suit : « la banque est légalement responsable envers son client au cas où elle ne l’informe pas de l’acceptation de l’ouverture du crédit documentaire, dans les délais raisonnables. Le client est alors, en droit de demander réparation du préjudice qui l’a affecté suite à la perte due à l’inexécution de la transaction commerciale »[13].
A la vérité la jurisprudence marocaine est très révélatrice quant au contrôle rigoureux exercé sur le banquier notamment en ce qui concerne son obligation de notification, la position est alors facilement explicable, d’une part notre judicaire tend à faire respecter les droits légitimes des parties, en l’occurrence l’acheteur, d’autre part à prémunir la renommé des banques nationales qui peuvent, par tels agissement, mettre en péril la réputation de notre place financière ; par-là même il s’agira de préserver la crédibilité et l’efficacité du mécanisme qui, enfin de compte, n’est qu’un moyen de paiement qui sécurise le paiement.
En outre le problème s’oppose également au niveau de la rareté des jurisprudences marocaines en matière de notification, ce qui a répercuter négativement sur la pratique judicaire, dans la mesure où nos magistrats non pas encore reçu une formation solide sur les techniques du crédit documentaire plus précisément et sur le droit de commerce international généralement, chose qui rend les arrêts et les décisions en la matière n’est pas souhaitable a ce niveaux. Il faut même souligner que ces arrêts restent inédits[14]. Bref, La technique du crédit documentaire n’est pas facilement assimilée par les tribunaux marocains du fond. Sans doute est-ce lié à la rareté du contentieux[15].
A ce titre, le juge marocain doit être conscient de l’importance du crédit documentaire, et doit suivre le courant de la jurisprudence comparée, puisque, dans le cas contraire, il peut contribuer à la déformation de l’image du pays aux yeux des investisseurs étrangers, ce qui peut avoir des retombées négatives sur l’économie nationale. Or, d’après cette modeste lecture de la jurisprudence marocaine, le juge a fait l’audace d’appliquer les RUUCD et de statuer en embrassant un raisonnement similaire à celui des autres partenaires économiques au Maroc[16].
BIBLIOGRAPHIE
Jamel. BACCAR, La sécurité de l’importateur et le crédit documentaire : Elément de Droit Comparé, Thèse de doctorat en Droit privé, Université Toulouse 1, Centre de Publication Universitaire 2008, p. 565.
Jacques. BÉGUIN et Michel. MENJUCQ, Droit du commerce international, LEXISNEXIS, 2e édition 2006, p. 579.
F.Grua, La responsabilité civile du banquier, RAÏD Hamadi Ben Lakhdar, Regroupement Latrach du livre spécialisé 2009,
EL WALI. Mohammed et SADDOUGUI. Mohammed, Crédit documentaire, Université Mohammed 1 Oujda
BOUKAICH. Khalid, Le crédit documentaire à l’épreuve des référés, 05/02/2015.
Saїd. ANASSE, Contribution à l’étude de la responsabilité du banquier en matière d’engagement bancaires, 1ère édition, p. 185-186.
ARHZAF. Dounia, Droit et pratique du crédit documentaire au Maroc, DESA 2005-2006, p. 150.
ذ. أنس أبو خصيب, مسؤولية البنك في الاعتماد المستندي على ضوء مستجدات النشرة 600 للقواعد و الأعراف الدولية, المجلة المغربية لنادي القضاة, العدد الثاني –صيف2013
أحمد الكويسي, الاعتماد المستندي الغير القابل للإلغاء, اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص, جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية فاس, السنة الجامعية 1996-1997
[1] Papamatthaiou. Anna-Georgia, La fraude dans le crédit documentaire, Université Robert Schuman, DEA DROIT DES AFFAIRES, année universitaire 2003-2004, p.74.
[2]La sécurité de l’importateur et le crédit documentaire : Elément de Droit Comparé, Centre de Publication Universitaire 2008, p. 565.
[3] Jacques BÉGUIN et Michel MENJUCQ, Droit du commerce international, LEXISNEXIS, 2e édition 2006, p. 579.
[4] La sécurité de l’importateur et le crédit documentaire : Elément de Droit Comparé, Centre de Publication Universitaire 2008, p. 565-571.
[5] Jacques BÉGUIN et Michel MENJUCQ, Droit du commerce international, op., cit., p. 579.
[6] Idem.
[7] La sécurité de l’importateur et le crédit documentaire : Elément de Droit Comparé, Centre de Publication Universitaire 2008, p. 579-581.
[8] S’il en est ainsi c’est parce que « si le contrat qui lie la banque réalisatrice à la banque émettrice est un mandat, celui qui lie la banque émettrice au donneur d’ordre n’en est surement pas un : c’est simplement un contrat d’ouverture de crédit. De même, les services d’une banque notificatrice relèvent du contrat d’entreprise plutôt que du mandat, puisqu’on ne lui demande pas d’accomplir d’actes juridiques » : F.Grua.
[9] La responsabilité civile du banquier, RAÏD Hamadi Ben Lakhdar, Regroupement Latrach du livre spécialisé 2009, p. 382-383.
[10] Idem.
[11] ARHZAF. Dounia, Droit et pratique du crédit documentaire au Maroc, DESA 2005-2006, p. 150.
[12] مسؤولية البنك في الاعتماد المستندي على ضوء مستجدات النشرة 600 للقواعد و الأعراف الدولية, ذ. أنس أبو خصيب, المجلة المغربية لنادي القضاة, العدد الثاني –صيف 2013, ص 376
[13] Saїd. ANASSE, Contribution à l’étude de la responsabilité du banquier en matière d’engagement bancaires, 1ère édition, p. 185-186.
[14] الاعتماد المستندي الغير القابل للإلغاء أحمد الكويسي, اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص, جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية فاس, السنة الجامعية 1996-1997 , ص7-8
[15] BOUKAICH. Khalid, Le crédit documentaire à l’épreuve des référés, 05/02/2015.
[16] EL WALI Mohammed et SADDOUGUI Mohammed, Crédit documentaire, Université Mohammed 1 Oujda, p. 27.